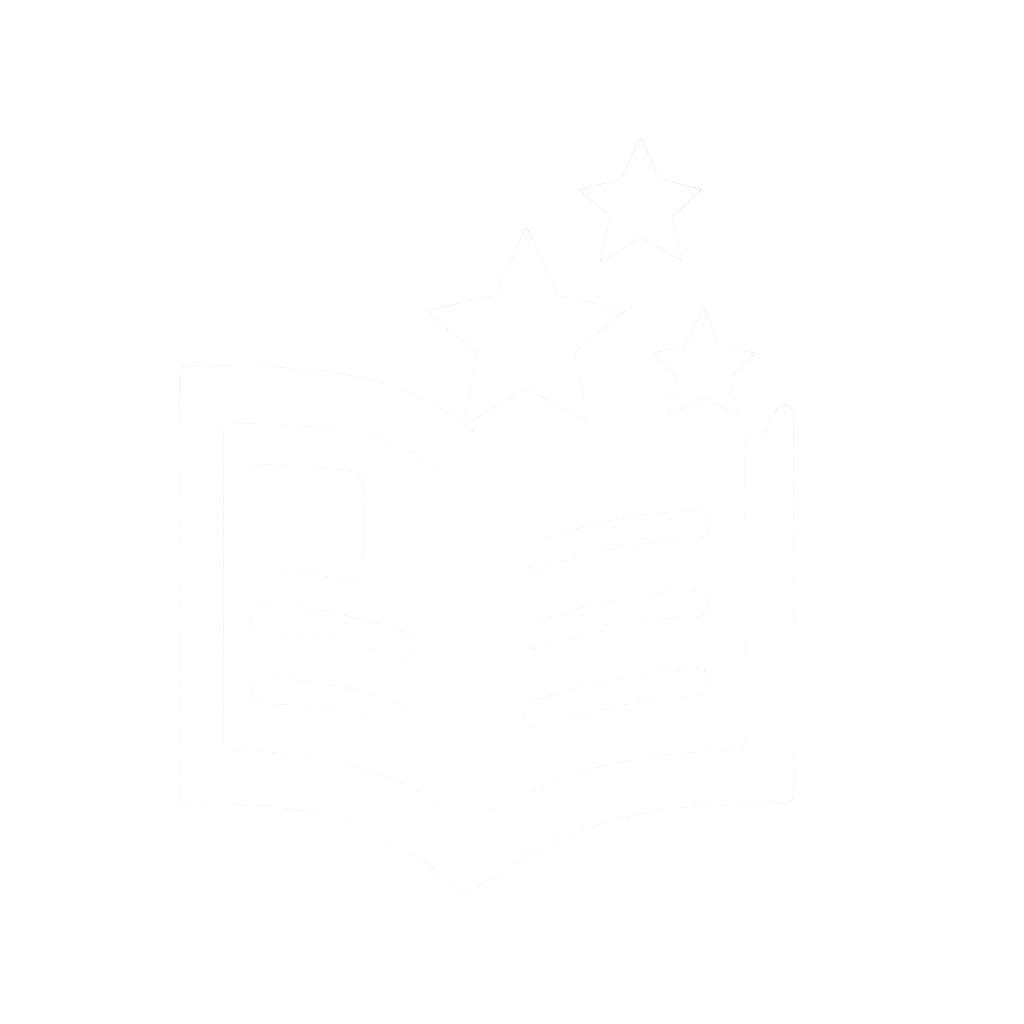Peut-on encore être dans ses pensées ?
Peut-on encore être dans ses pensées ?
hschlegel
mer 15/10/2025 - 17:00
En savoir plus sur Peut-on encore être dans ses pensées ?
Rivés à nos écrans, nous sommes en permanence assaillis d’informations. Comment, dans un tel contexte, retrouver la capacité à dialoguer avec soi ? Quelques pistes pour comprendre les menaces qui pèsent sur notre intériorité, et nous réapproprier un espace mental essentiel.
[CTA2]
Le flux perpétuel d’informations dans lequel nous sommes plongés a engendré les concepts d’infobésité ou de fatigue informationnelle. À cela s’ajoutent un scrolling envahissant, une place prépondérante des réseaux sociaux qui captent notre attention, souvent malgré nous, et qu’on tient pour responsables d’une anxiété croissante chez les jeunes comme d’une détérioration de la concentration à tous les niveaux. Ces mutations récentes interrogent : peut-on encore « être dans ses pensées » aujourd’hui ? S’agit-il d’un luxe que la plupart d’entre nous a irrémédiablement perdu ?
Du contenu comme remplissage
Tout commence par une expérience à la portée de chacun. À l’attente d’un bus, d’un métro ou d’un tramway, ne pas dégainer son téléphone : résister à l’appel des notifications et de leur dopamine sécrétée, et observer autour de soi. Il y a fort à parier que toutes les personnes présentes auront cette étrange posture, nuque cassée, front baissé, absorbées par l’écran que leur pouce fait défiler. Une fois à l’intérieur du bus ou du wagon, même constat : des individus qui semblent hypnotisés par leur téléphone, qui ne vous voient pas monter, qui ne regardent ni leur environnement ni leur voisin. On a beau le savoir, lorsque l’on renonce à prendre en main son téléphone un moment, il y a de quoi être décontenancé : dans quelle dystopie vivons-nous ?
“On a beau savoir que tout le monde est sur son téléphone, partout, tout le temps, lorsqu’on renonce à le prendre en main un moment, il y a de quoi être décontenancé : dans quelle dystopie vivons-nous ?”
Arrêts de bus, files d’attente d’un magasin, d’un bureau de poste, quais de gare ou de métro, passages piétons : ces situations où nous sommes contraints de patienter sont désormais remplies de manière uniforme par du temps d’écran, de podcasts, de vidéos et tout un tas de contenus. Il en va de même dans les lieux de sociabilité ou d’intimité : restaurants, parcs, terrasses, salon ou chambre à coucher, là où nous pouvions errer mentalement, n’ayant rien à faire sinon réfléchir, engager la conversation ou lire un livre, nous sommes désormais habitués à être captés passivement.
La discussion avec autrui, comme celle que nous entretenions avec nous-mêmes, a largement disparu. Or, être dans ses pensées revient précisément à entretenir un cheminement intime, autour de ce que l’on a vécu, de ce qui se passe présentement ou de ce qui adviendra. Happé par les smartphones, nous cessons alors de nourrir aussi bien notre dialogue intérieur que la créativité de nos idées.
“Notre esprit est devenu un simple contenant dans lequel on verse des informations ou des anecdotes disparates”
Le terme de « contenu » qui définit tout ce qui est produit ou publié sur les réseaux sociaux (vidéos, textes ou photos) n’a rien d’anodin : notre esprit est devenu un simple contenant dans lequel on verse des informations ou des anecdotes disparates, sans hiérarchie ni cohérence, toutes proposées aléatoirement par un algorithme qui semble bien nous connaître. On passe ainsi d’une vidéo d’humour à un article de presse, d’un extrait de reportage aux photos de vacances d’un lointain collègue – et c’est parfois à se demander ce qui nous a poussés à débarquer sur « le profil » d’une personne, ne sachant même plus ce qu’on y fait ni mesurant le temps passé.
L’errance qui égare… et celle qui éclaire
Il y a bien une forme d’errance perverse dans cet usage permanent des réseaux sociaux et des applications, à l’opposé de l’errance souhaitable et nécessaire qui est celle de nos pensées. La première nous perd, la seconde nous offre un répit salutaire et nous éclaire. Contrairement à l’idée reçue, « se perdre dans ses pensées » est fructueux : c’est lorsque l’esprit est libre qu’il mémorise, opère un discernement, se projette ou établit des associations d’idées, des liens et des nouvelles pensées. Une inattention qui a presque disparu.
Le remplissage des temps d’attente, ou de ceux jugés non productifs, constitue le premier frein à nos divagations mentales : les temps de flottement dont notre esprit s’emparait n’existent plus, ils ont été supplantés par des outils qui assurent un flot infini d’informations ou de distractions. Ainsi, la fonctionnalité de l’infinite scrolling (défilement infini) empêche toute satiété, conditionnant le cerveau à ingurgiter toujours plus… jusqu’au doomscrolling (défilement anxiogène), ce néologisme qui définit quant à lui un cercle vicieux poussant à enchaîner de manière obsessionnelle les informations négatives, façonnant une angoisse existentielle.
“Nous avons développé une aversion pour les vides et remplissons désormais tous les silences, là où auparavant seule la latence existait”
Autant de pratiques qui s’emparent de notre cerveau, ne laissant pas de place à la réflexion et bien peu à la volonté. C’est peut-être par désir mimétique autant que pour nous donner une contenance (justement) que nous nous emparons aussi machinalement de notre téléphone : nous sommes agis plus qu’acteurs de notre comportement, et nous ne contrôlons plus ce à quoi nous pensons.
Le remède serait alors de parvenir à lever les yeux sur ce qui nous entoure, ce qui exige un effort : ne rien prendre en main, appréhender une forme de béance, devient une rééducation à l’observation comme à la pensée. Réapprendre à ne rien faire, en somme.
“Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi” Jean-Jacques Rousseau
Dans ses Rêveries du promeneur solitaire (publiées à titre posthume en 1782), Rousseau explique comment la solitude est une condition pour se rapprocher de soi-même, et comment la contemplation permet d’expérimenter pleinement le sentiment d’exister : « Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. »
Il ne s’agit donc pas de s’égarer mais de se réapproprier, et de coïncider avec soi-même. Aujourd’hui, si l’on est seul et sans activité, combien de temps est-on capables de se laisser aller à la rêverie ?
L’instantané contre la décantation
Mais la confiscation de nos pensées ne provient pas seulement des smartphones ou des réseaux sociaux. Le règne de l’instantané a lui aussi supplanté la latence à laquelle toute action était soumise, il y a dix ans encore. Les messages sont dictés, ou vocaux, les réponses sont attendues immédiatement, les confirmations de lecture nous indiquent « en temps réel » (le temps peut-il autrement ?) si notre destinataire a lu ou non notre message. Une étape supplémentaire a été franchie dans la communication instantanée, comme dans la recherche d’informations : l’intelligence artificielle répond en quelques secondes à toute question, reléguant les recherches en ligne à une certaine obsolescence.
L’accélération est l’un des concepts majeurs du philosophe allemand Hartmut Rosa : au lieu de nous permettre de dégager du temps, tout ce qui accélère la société (les outils de communication, les transports, la logistique) contribue à une fuite en avant, de sorte que là où l’on traitait quelques courriers par jour, on traitera aujourd’hui une quarantaine de mails et des dizaines de messages. L’exemple du courrier est emblématique : le discours que l’on tient est bien différent entre un échange épistolaire manuscrit (très rare aujourd’hui), un mail et des messageries instantanées. Or, cette instantanéité protéiforme va à l’encontre de la réflexion, qui nécessite du temps, celui de l’infusion, de la décantation des idées : ce que l’on fait lorsqu’on se plonge dans ses pensées.
“Tout ce qui accélère la société (les outils de communication, les transports, la logistique) contribue à une fuite en avant. L’instantanéité protéiforme va à l’encontre de la réflexion”
Le remède consisterait à désobéir à l’exigence de l’instantané et à redoubler de vigilance à l’égard de soi-même : ce n’est pas parce que je lis ce qu’on m’écrit que je dois répondre sur-le-champ. Prendre une journée ou deux de réflexion sur un problème – ou ne pas céder à l’attente supposée du destinataire – est coûteux, car nous jouons tous ce jeu de la disponibilité permanente. Mais nos pensées, elles, le sont de moins de moins. Savoir se rendre indisponible devient une hygiène de vie et une discipline à exercer.
“Nulle part l’homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme” Marc Aurèle
Bien avant l’essor des notifications, l’empereur stoïcien Marc Aurèle conseillait de se couper des sollicitations extérieures pour se retrier en soi-même : « On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Et toi-même, tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d’isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l’heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l’homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme […] » (Pensées pour moi-même, Livre IV, 3).
Mais n’est-ce qu’une question de volonté ?
Retrouver le silence
Si nous peinons tant à cesser de scroller ou à résister à l’instantanéité, c’est aussi parce que les activités silencieuses, où l’on pouvait s’entendre penser, se sont réduites. C’est la troisième barrière à lever : celle du bruit, du son permanent. Qu’il soit podcast, radio, émission, entretien, information en continu, il envahit toutes les activités où la latence existait, accompagnée de notre seul dialogue intérieur. Dans nos trajets quotidiens, pendant les tâches ménagères… Tout comme nous avons développé une aversion pour le vide, nous avons rempli les silences.
“Savoir se rendre indisponible – aussi pour les destinataires de nos messages – devient une hygiène de vie et une discipline à exercer”
Tout le malheur des hommes vient-il de ne plus pouvoir écouter ses propres pensées ? Derrière toutes ces paroles qui nous gagnent se trame aussi une injonction à la rentabilité : même les moments où les tâches sont les plus anodines, nous ne résistons souvent pas au réflexe de les agrémenter d’une émission de radio, d’un environnement musical, d’un discours qui nous atteint. Si tous ces outils offrent une ouverture immense sur la culture ou le monde, ils entraînent aussi la disparition des temps de silence.
Un court reportage, rediffusé récemment sur les réseaux sociaux, a suscité un engouement éloquent : il montre Denise, 71 ans, laver ses draps au lavoir de sa commune, avec le sourire. « Quand on brosse le linge […] les idées noires, la colère, la rage, […] ça permet d’évacuer beaucoup de tensions qui s’accumulent », explique-t-elle. Être dans ses pensées ne signifie pas ressasser ou ruminer, mais au contraire trier, ordonner et ranger son esprit.
Le remède pour préserver cet écrin mental et rendre nos pensées audibles à nous-mêmes est de réapprendre à écouter le bruit de nos gestes, celui du lieu où nous nous trouvons, sans écouteurs, sans casque ni médias audio – et à faire cesser, ne serait-ce que pour un instant seulement, la cacophonie ambiante.
octobre 2025